
O autor de "M. Ibrahim et les Fleurs du Coran" e "Variations Énigmatiques" fala sobre o Zen, a Adolescência, o descobrimento de Deus e seu útlimo romance "Le Sumo qui ne pouvait pas grossir" à revista "Le Monde des Religions", em entrevista concedida a Jennifer Schwartz
Voici un homme qui ne supporte aucune assignation. Quand Éric-Emmanuel Schmitt se passionne pour des figures historiques, elles s’appellent aussi bien Freud, Diderot que Jésus ou Hitler. Romancier, auteur de pièces de théâtre et depuis peu réalisateur, Schmitt n’en finit pas de changer de peau, d’espace, de forme… Et lorsqu’il veut parler de quête et d’élévation spirituelles, il aime à naviguer d’un continent à l’autre, de la culture chrétienne à la tradition juive, islamique et jusqu’au bouddhisme. Expatrié à Bruxelles où il mène une vie à saine distance de Paris, il incarne désormais, aux yeux de son public, une sorte d’homme universel. Son dernier ouvrage "Le Sumo qui ne pouvait pas grossir", écrit dans une langue volontairement épurée, nous emmène par petites touches philosophiques sur les traces du Japon, l’un des berceaux du bouddhisme zen.
Pourquoi avoir choisi de situer l’intrigue de ce livre au Japon ?
Mes livres ont cette volonté d’explorer et de rendre l’autre moins lointain. Faire en sorte que mon prochain soit vraiment mon proche. Or, nous éprouvons à l’égard du Japon un double éloignement, dans l’espace et dans le temps, car le passé de ce pays furieusement moderne est encore très présent, sous la forme notamment du théâtre kabuki et du théâtre Nô. J’ai voulu réduire ce double éloignement, créer une proximité avec cette culture, à travers le sumo et le bouddhisme zen.La délivrance du héros passe par l’apprentissage du sumo. Êtes-vous un adepte de cette discipline ?
Une amie avocate m’a invité un jour à un match de sumos. Ne voyant là qu’un spectacle pathétique et de pauvres êtres à mettre en clinique immédiatement, elle a attisé ma curiosité en m’avouant son penchant pour ces lutteurs extraordinaires, qu’elle trouvait très beaux… C’est tout ce que j’aime : quand l’autre m’offre un regard différent sur la réalité. J’y suis donc allé et j’ai été fasciné. On croit au départ lorsque les deux adversaires montent sur le ring que le combat est joué d’avance et que le plus massif va triompher. Or l’astuce, l’intelligence, le sens de l’autre, l’anticipation de ses actes, peuvent compenser ce qui manque en volume, en poids et en masse. Peu à peu, on se prend au jeu, on change totalement ses catégories esthétiques et athlétiques. Ces corps totalement imberbes et doux apparaissent comme très onctueux. Les modèles du masculin changent, allant vers le féminin. C’est assez fabuleux.
Le bouddhisme zen est l’autre levier qui pousse le héros à s’ouvrir au monde…
Lors de ma première visite au Japon, voyageant avec des Japonais, je me suis rendu dans un jardin zen à Kyoto et là, il se passa cette chose que je place dans la bouche de Jun : dans ce jardin de pierre, par désœuvrement et par politesse, je me suis assis au bord du jardin zen. J’ai tout d’abord été happé par des pensées négatives. Mais très vite, j’ai eu ce sentiment d’entrer dans un autre état de conscience, de me dissocier de mon corps. J’ai ressenti une sorte d’éclatement physique. Ce n’était ni souhaité, ni voulu, ni même soupçonné.
Sans exercice préalable de méditation ?
Le jardin zen a fait tout le travail, même si j’ai une nature plutôt réceptive. J’ai donc vécu cet immense vagabondage de l’âme, avec la sensation tout à coup que ce n’était pas ma propre conscience qui pensait mais une conscience plus cosmique. Ce fut une expérience violente, retentissante. Elle fut à la base d’un véritable intérêt développé ensuite par la lecture.
Vous avez choisi de raconter l’histoire d’un adolescent qui est en train de mourir au monde, par refus de grandir. Pourquoi ?
L’adolescence n’est pour moi pas un âge mais un état que je porte toujours en moi. Après l’enfance, cette infinité des possibles qui nous autorise à rêver de tout, vient le moment de la vie où l’entonnoir des possibles devient de plus en plus étroit. Il ne conduit plus qu’à la réalité : ce corps, ces pulsions, ces études, cette vie, ce milieu social. Je ne sais pas si j’y ai moi-même jamais consenti. Je suis romancier, dramaturge et donc je crée une autre réalité. Mon héros, Jun, souffre d’une « allergie universelle », il s’est coupé de sa famille, de la société, enfermé dans le mutisme car consentir à la réalité lui paraît effrayant. C’est la rencontre avec un homme plus âgé, qui va bouleverser son univers. « Je rêve quelque chose pour toi. Tu es plus que ce que je vois », lui signifie Shomintsu. C’est la base de la rencontre humaine et cela peut changer une vie.
Cela vous est-il arrivé ?
J’ai plusieurs fois été diagnostiqué de quelque chose par quelqu’un, et cela m’a donné des ailes. Vers 16 ou 17 ans, je voulais faire le conservatoire mais mon imagination musicale était médiocre. En revanche, j’écrivais de façon si naturelle que je n’y voyais aucun mérite particulier. Mes profs de français m’ont diagnostiqué écrivain à partir de la quatrième, cependant cette vocation demeura sourde longtemps. Mes études de philosophie ont tué l’écrivain spontané, ne laissant de place qu’à l’hémisphère du cerveau qui analyse, conceptualise. Il m’a fallu du temps pour accepter d’être écrivain…
Comment s’est opéré le basculement ?
Avec la découverte de Dieu. Lors d’un voyage dans le désert, je me suis perdu seul pendant 36 heures sans eau ni nourriture de survie. Cette nuit passée sous les étoiles aurait dû me faire peur, mais j’ai alors accepté la finitude de mon esprit. Avant, j’avais l’esprit qui allait d’un côté, le cœur ailleurs et le corps un peu partout. Cette expérience m’a unifié. Je viens d’une famille athée et je m’étais construit avec l’idée philosophique et républicaine que l’expérience n’étant pas partageable, elle ne m’intéressait pas. Et tout d’un coup, je me suis retrouvé dans l’expérience, dans le scintillement du sens. J’ai mis des années avant de prendre la parole, mais cette nuit faisait son chemin en moi. J’ai lu peu à peu les grands textes religieux révélés et surtout les mystiques de chaque religion, avec lesquels je me sens plus en résonance. J’ai commencé par l’Orient, puis j’ai fini par lire les évangiles. Ce texte me bouleversa car il plaçait l’amour au-delà de toute autre valeur. Lors de ma nuit dans le désert, je n’avais pas éprouvé cette dimension. Ce fut le début d’une obsession.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le bouddhisme zen ?
Cette possibilité de se débarrasser de soi. Cet appel à ne pas penser avec sa conscience mais avec une conscience cosmique. Pour le philosophe que je suis, cela ne fait aucun sens, mais en expérience, je peux l’éprouver. Je suis passé d’une conception rationalisante de l’esprit à une conception ouverte qui accepte la suscitation de l’expérience, de la révélation, de l’art, de la rencontre. Bref, j’ai cessé de considérer mon esprit comme purement rationnel. J’ai ouvert les vannes.
Le bouddhisme et le christianisme sont-ils proches à vos yeux ?
Ils ont la même fonction pacifiante, liante, qui consiste à abolir la distance entre soi et l’autre, à créer du lien entre les humains, mais ils n’ont pas le même sens. Dans le christianisme, il y a cette idée que chacun est unique. Dans le bouddhisme, au contraire, on doit se « désindividuer », se désingulariser, se débarrasser de ses attachements pour ne pas souffrir. C’est une philosophie de vie qui m’intéresse beaucoup et qui, en même temps, me choque, car je tiens violemment à souffrir de mes attachements. En cela, je me sens chrétien.
Le Sumo qui ne pouvait pas grossir
Eric-Emamanuel Schmitt
Albin Michel
R$ 55,00
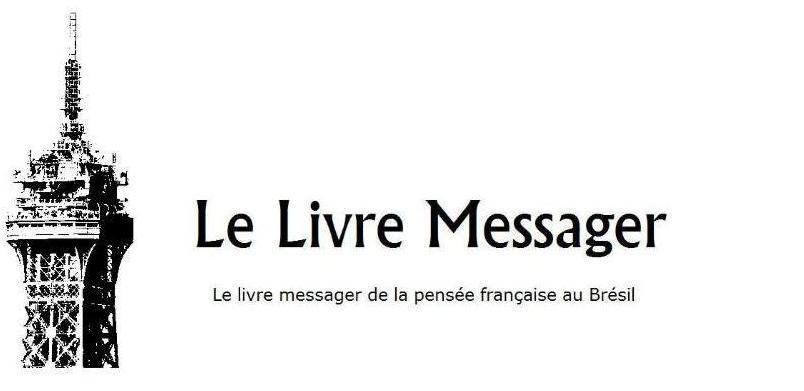




















Nenhum comentário:
Postar um comentário