Science et Avenir
Le chercheur dénonce les préjugés qui pèsent sur la science et la technique et rappelle que les produits industriels, si souvent décriés, ont tous une origine naturelle.
Dans votre dernier ouvrage, vous pointez des préjugés qui influencent notre perception de la science et de la technique. Lesquels?
En premier lieu, une dévalorisation, qui se manifeste, par exemple, dans le fait que les lycées techniques sont souvent déconsidérés. Ensuite une dévalorisation de l´écriture via le calcul, car n´oublions pas que les premières écritures étaient des livres de comptes. Enfin, l´idée que la nature est toujours vertueuse, fondamentalement bonne, et que l´action humaine est toujours une pollution de la nature. Nous oublions trop vite que si la vie a pu se développer sur Terre, c´est très probablement parce que des gaz à effet de serre ont été émis par des volcans et ont provoqué un réchauffement de plus de 30 ºC...
En corollaire, nous aurions donc pour préjugé que l´industrie n´est qu´un agent perturbateur de l´harmonie naturelle?
Exactement. Nous assistons a une sacralisation de la nature, dont le paroxysme est l´ulitilisation, souvent abusive, de l´adjectif "naturel" ou "biologique". Tous les éléments chimiques existent dans la croûte terrestrre, même si certaines combinaisons sont des poisons. Les produits issus de l´industrie ne peuvent donc être que naturels, car leurs ingrédients ont été puisés dans la nature même... les OGM proviennent aussi du millieu biologique. Selon vous, cette dévalorisation de la technique serait un héritage de l´organisation des societés de l´Antiquité. C´est l´hypothèse que je propose. L´idée que cette dévalorisation de la technique provient d´un préjugé à l´encontre de la fonction productive. L´historien Georges Dumézil a etudié les cultures anciennes d´une région qui englobe l´Europe, l´Asie Centrale et le nord de l´Inde. Ces sociétés s´organisaient en trois groupes: le clergé, l´aristocratie et la roture. Les roturiers qui gagnaient leur vie comme artisans, paysans ou commerçants étaient en bas de l´échelle sociale. Il était plus noble et valeureux de faire la guerre et piller que de travailler pour produire.
Ya-t-il eu des périodes de l´histoire pendant lesquelles ces préjugés ont étés écartés?
Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, de Galilée aux encyclopédistes, ces préjugés semblent avoir reculé et laissé place à une valorisation de la raison. Mais l´avènement du Romantisme, à la fin du XVIIe siècle, a marqué leur retour. Les romantiques célèbrent la nature, mais pas celle qu´étudient les sciences de la nature: une nature merveilleuse et insondable, qui échappe à la raison et à l´investigation scientifique. Leur opposition entre l´art et la technique nous a aussi fait oublier qu´à l´origine ces deux activités ne sont qu´une.
Le XXe siècle a-t-il modifié cette vision?
Bien au contraire! Le paroxysme a été atteint à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs philosophes ont alors fait remarquer - avec raison - que massacrer des millions de personnes en quelques mois, comme venait de le faire le régime nazi, exigeait une grande logistique et l´emploi de "méthodes industrielles". La philosophe Hannah Arendt évoque ainsi "une machinerie d´extermination". L´amalgame entre industrie et technique, technique et science, science et raison permet de conclure à un "massacre rationnel". Cela a profondément marqué l´image de la technique.
Comment peut-on lutter contre ces préjugés?
En les décryptant et les dénonçant sans cesse. Ce livre est un réaction mûrie pendant plusieurs anées a une petite phrase que j´ai entendue un jour - comme chacun de nous en entend quotidienemment - alors que je faisais la queue chez un marchand de glaces. Un petit garçon préférait un esquimau "industriel" à une boule patissière. Sa mère s´est alors écriée: "Non pas une de ces cochonneries industrielles pleines de produits chimiques!" en oubliant que le froid nécessaire à l´élaboration de la glace était le fait de l´industrie et que le sorbe pâtissier était également chimique.
http://sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com/hebdo
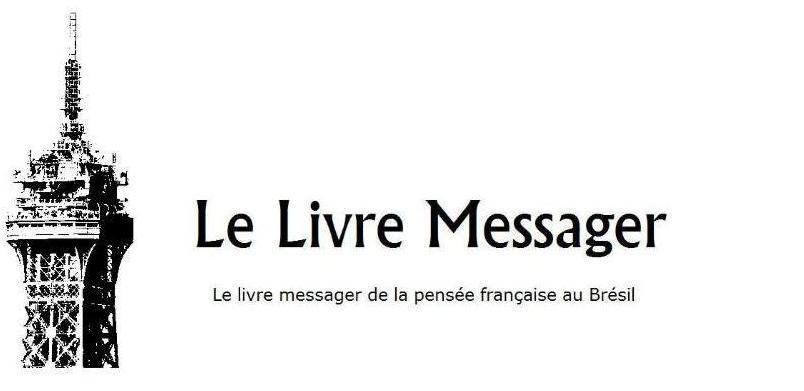




















Nenhum comentário:
Postar um comentário