Thomas Wieder
"C'est une tentation pour les cinéastes, même ceux qui ne s'intéressent pas tellement à l'histoire, de faire des films historiques", confiait Eric Rohmer, en février 2001, à l'historienne du cinéma Priska Morrissey (entretien paru dans "Historiens et Cinéastes : Rencontre de Deux Écritures", L'Harmattan, 2004). Cette "tentation", Eric Rohmer y succomba à cinq reprises, dans une œuvre où la fiction historique occupe une part congrue. Sa relation au genre n'en est pas moins exemplaire de son cinéma, qui privilégie l'intimisme, la fable, la médiation artistique.
Il parcourt tour à tour les premiers temps du romantisme (La Marquise d'O…, 1976), le Moyen Age (Perceval le Gallois, 1978), les débuts de la Révolution française (L'Anglaise et le Duc, 2001), la fin des années 1930 (Triple agent, 2004), et une Gaule imaginaire passée au filtre du XVIIe siècle naissant (Les Amours d'Astrée et Céladon, 2007).
Passionné d'histoire ("J'aurais pu l'enseigner", disait-il), capable, quand il préparait un long métrage, de passer des journées entières à la Bibliothèque Nationale ou au Musée Carnavalet pour recopier des miniatures et des gravures, il ne concevait pas pour autant ses fictions historiques comme de simples reconstitutions naturalistes.
Adaptation
Il s'en expliqua notamment en 1981 dans la revue Enseignement 2000. Interrogé au sujet de Perceval le Gallois, il indiqua que son ambition avait été de "recréer un monde tel que se le représentaient les gens du Moyen Age, et non pas le monde tel que l'on aurait pu le photographier si l'on avait eu l'appareil pour le faire".
Dans cette conversation avec Fabrice Luchini et les actrices du film, dont Arielle Dombasle, diffusée dans l'émission "Ciné Regards" en 1979, Eric Rohmer explique son goût pour la "langue du Moyen Age".
Ce souci de restituer "la vision des gens d'autrefois" plutôt qu'une réalité supposée objective explique pourquoi la plupart des films historiques d'Eric Rohmer sont des adaptations de textes littéraires. Le cinéaste considérait en effet que mettre ses pas dans ceux d'un auteur, en allant jusqu'à en épouser la langue, était la meilleure des garanties d'authenticité.
Son choix de transposer à l'écran le Journal de ma vie durant la Révolution Française, de Grace Elliott, ne s'explique pas autrement. "Il s'agit d'un texte déjà écrit comme un scénario, confiait-il au Monde à la sortie de L'Anglaise et le Duc. La plupart des scènes viennent directement du livre, sans avoir même besoin de modifier les dialogues."
Dans ce reportage diffusé au moment de la sortie du film sur France 3, les acteurs de L'Anglaise et le Duc et le peintre responsable des décors évoquent la reconstitution du Paris de la Révolution.
La volonté de montrer une époque telle que ses contemporains se la représentaient aura conduit Eric Rohmer à s'inspirer de près de certains peintres, comme dans La Marquise d'O…, où Füssli, Greuze et Ingres sont cités de façon quasi transparente. Mais aussi à imaginer des mises en scène extrêmement sophistiquées.
En ce domaine, le sommet a sans doute été atteint dans Perceval le Gallois, où, par fidélité aux représentations médiévales, le cinéaste a délibérément rompu avec le respect des proportions physiques et les codes de la perspective. "Cette transposition, disait-il, vaut mieux pour moi que toutes les ruines médiévales auxquelles on a toujours recours."
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/12/rhomer-a-voulu-restituer-la-vision-des-gens-d-autrefois_1290399_3476.html#ens_id=1290326
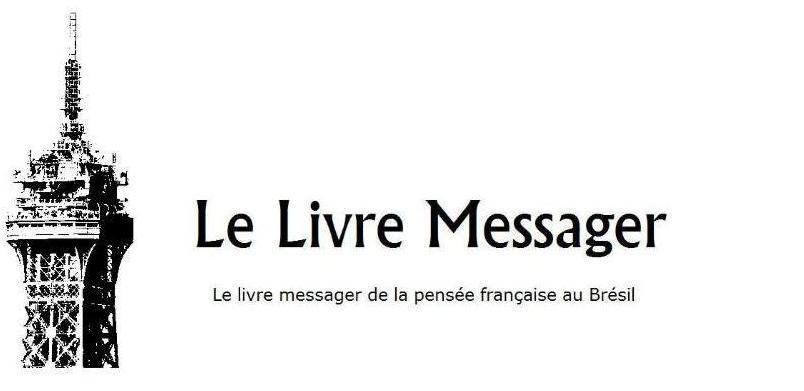




















Nenhum comentário:
Postar um comentário